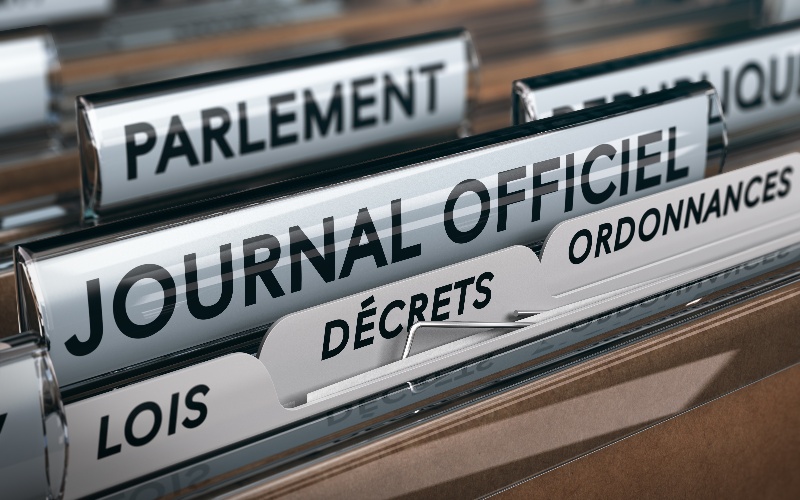La cathédrale Notre-Dame D'Amiens ou le Gothique flamboyant
Publié le 05 janvier 2005, mis à jour le 30 avril 2025 à 19h10, par Camille Decambu

Les codes de la couleur
Les pensées et les croyances des hommes du Moyen Age sont bien loin des nôtres et leur façon d'appréhender et d'utiliser les couleurs peut surprendre.
- Le bleu par exemple, était alors considéré comme une couleur chaude. L'Eglise a ainsi consigné les couleurs liturgiques au Concile de Nicée en 325.
- Le violet est défini comme la couleur de la prière (confirmation en 1215, au Concile de Latran IV).
- Le vert symbolise déjà la fertilité de la terre, la vie nouvelle et l'état de grâce.
- Le blanc, le baptême.
- Le rouge pourpre de l'Eglise byzantine désigne la passion du Christ et le supplice des martyrs. Il exprime également le feu et la foi. Lorsque se développe la dévotion envers Marie, celle-ci est ainsi habillée de bleu ciel et de rouge, parce qu'elle est reine du ciel et mère de Dieu.
Pourquoi la couleur ?
L'imaginaire des couleurs traduit sans aucun doute une symbolique. L'iconographie religieuse retient les nouvelles règles des couleurs. Le bleu devient l'attribut de la vierge au moment où la dévotion envers Marie se généralise. L'essor du bleu n'a pas été sans susciter de fortes réactions de la part des teinturiers du rouge et des marchands de garance : la concurrence fut si forte qu'en commandant des vitraux ils insistèrent parfois auprès des maîtres-verriers pour qu'ils destinent le bleu au diable ou à l'enfer (signe de discrédit, mais pour nous, haut témoignage de la symbolique des couleurs au Moyen Age. Les gens du Moyen Age ont le goût des matières brillantes et des teintes éclatantes. Ils vénèrent la couleur, s'y réchauffent, s'y rassurent.
La question de la couleur s'associe à la théologie de la lumière qui s'épanouit parallèlement à la lente domestication de la lumière. Elle est donc divine. L'impact est d'autant plus grand que la lumière des lampes à huile est encore rare au Moyen Age et que le monde de la nuit est peuplé d'ombres menaçantes, de dangers, voire de créatures démoniaques. Face à ces peurs ancestrales et légitimes, mêlées de superstitions tenaces, les hommes se mettent en quête de la sécurité lumineuse et les architectes tentent alors de l'inscrire dans la pierre.