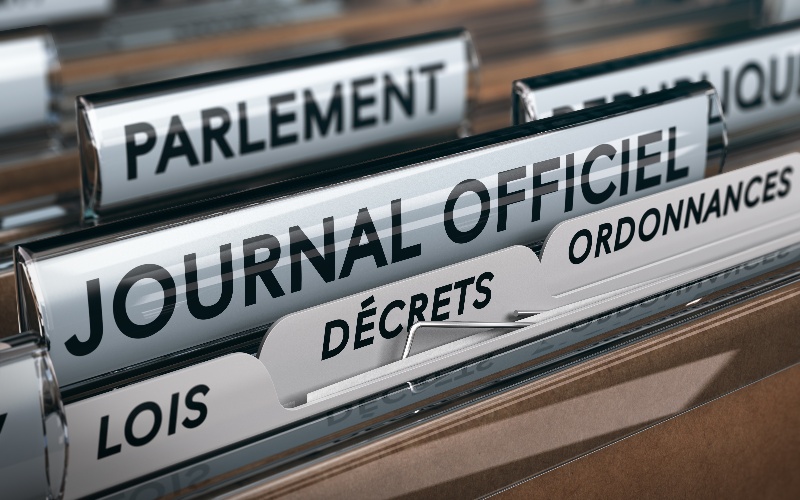Un dilemme pour les communes ... Faut'il restaurer ou non le patrimoine religieux ?
Publié le 11 octobre 2006, mis à jour le 30 avril 2025 à 19h43, par Camille Decambu
Cependant, quelques édifices, désacralisés, sont détruits ou recyclés à d'autres fins.
Le diocèse de Saint-Brieuc a vendu plusieurs chapelles construites dans les années 1960, notamment à Guingamp et à Loudéac, "qui n'avaient aucune valeur architecturale, nécessitaient d'énormes travaux, et n'étaient plus utilisées", selon le vicaire-général, Francis Morcel. En charge de l'entretien des églises paroissiales, les mairies n'ont, la plupart du temps, pas d'autres choix que d'assurer l'entretien de bâtiments, souvent surdimensionnés par rapport à leur population et à leur budget.
"Nous avons passé quatre ans à rechercher des financements pour assurer la restauration intérieure et extérieure de notre église, qui date de la fin du XIXe siècle et posait des problèmes de sécurité", témoigne Michel Vaspart, maire de Pleudihen-sur-Rance, petit village des Côtes d'Armor. "La restauration a coûté 1,4 million d'euros, et nous avons obtenu 58% de financement, notamment de la région et du département, ce qui est important pour une église non classée". Mais le coût supporté par la commune l'a amené à différer de trois ans la construction de sa salle des fêtes.
Face à de tels investissements, les petites communes sont parfois amenées à délaisser le petit patrimoine, comme les chapelles, laissant leur avenir aux mains de la société civile. De nombreuses associations ont ainsi été créées dans ce but, comme Breiz Santel en Bretagne, ou pour sauver un édifice en particulier, avec parfois la relance du "pardon", une fête religieuse qui permet de se réapproprier un lieu, mais également de relancer le financement des travaux.