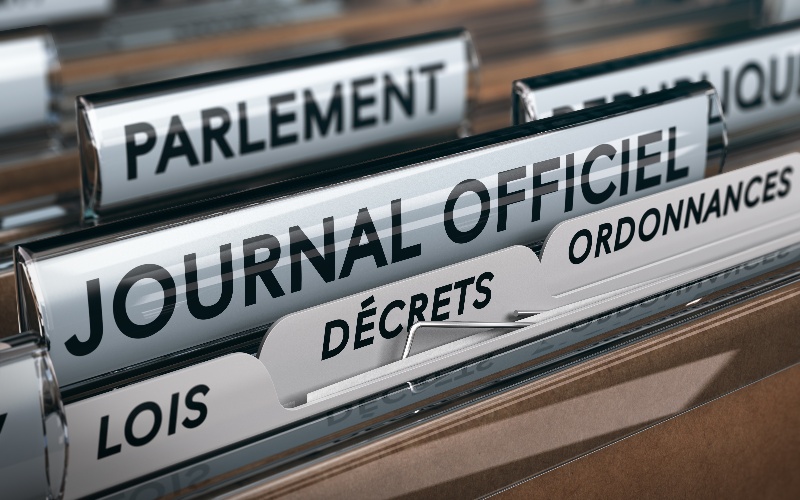À Artibat 2025, un pont de Léonard de Vinci dans l'air du temps
Publié le 24 octobre 2025, mis à jour le 03 novembre 2025 à 16h52, par Nils Buchsbaum

De l’Italie de la Renaissance jusqu’au salon Artibat 2025. Dans la Collab’Zone du salon - espace immersif de 400 m² dédié à l'innovation, la robotique et l'intelligence artificielle -, une structure intrigue les visiteurs.
C’est un pont semblable à celui inventé par Leonard de Vinci. En s’approchant, les curieux peuvent être surpris par les matériaux qui composent l’œuvre. Il semble y avoir du bois, mais aussi du plastique, du béton et du cuir. Le sol du pont est une mosaïque de couleurs et de matériaux qui forment ce qui laisse penser à de l’origami. Au centre, une rivière bleue, en cuir, porte des carpes elles aussi composées de peau.
Un ouvrage du XVIème siècle réinventé
Imaginé par l’artiste et inventeur italien à la fin du XVème siècle, sans clous ni vis, le pont de Léonard de Vinci repose à l’origine sur un système d’emboîtement de pièces de bois, utilisant uniquement la gravité et la tension pour assurer sa stabilité. Comme le démontre le projet présenté à Artibat, il continue d’inspirer architectes, ingénieurs et designers du monde entier.
La particularité de ce pont version 2025 est sa structure, composée de matériaux de réemploi. Elle combine design, ingénierie, modélisation numérique, résistance des matériaux et artisanat d’excellence.
Le pont, démontable et transportable, mesure six mètres de long, deux mètres de large et un de haut. Dès le début de sa conception, l’objectif était de l’exposer au salon Artibat 2025 comme un démonstrateur concret de la coopération de plusieurs secteurs. Les porteurs du projet souhaitent qu’il mette en lumière l’usage de matériaux variés et de technologies innovantes, tout en intégrant des principes de développement durable.
Fruit d’une collaboration internationale et interdisciplinaire portée par Nantes Université, le projet a vu la participation d’étudiants issus de divers établissements en France et au Japon, l’IUT de Saint-Nazaire et de Nantes, Polytech Nantes, la Faculté des Sciences et Techniques, le lycée Livet de Nantes, et l’ASO Architecture & Design College de Fukuoka mais aussi les Compagnons du Devoir.
Les nouvelles technologies peuvent aider à construire en réduisant l'impact environnemental
Tout démarre il y un an. Artibat demande à l’Université de Nantes de réaliser une œuvre pour la Collab’Zone. Le Manufacturing Lab (M-LAB) de la Halle 6 Ouest, un tiers-lieu universitaire nantais dédié à l’expérimentation et à la médiation scientifique et technique, se saisit du projet.
Sébastien Le Loch, enseignant-chercheur à l’IUT de Nantes et responsable scientifique du projet, nous explique les enjeux majeurs de cette initiative : « Nous avons relevé deux défis distincts. Le premier est technique, avec la fabrication de pièces en impression 3D, béton, polymère, ainsi que des éléments en bois issus de matériaux déclassés ou de déconstruction. L’autre objectif est de démontrer comment les nouvelles technologies peuvent permettre de construire tout en réduisant l’impact environnemental ».
Des étudiants en conception mécanique s’occupent de dessiner des pièces, des étudiants de génie civil font les calculs. Sébastien Le Loch contacte un collègue japonais spécialiste en design et en architecture qui, avec ses étudiants, apporte l’idée du sol en forme d’origami. Comme un hommage aux différentes cultures et époques capables de s'enchevêtrer.
« Les Compagnons du Devoir sont ensuite arrivés avec un œil complètement différent sur le projet » relate Sébastien Le Loch, pull noir siglé Univ Nantes sur le dos. « Ce sont eux qui ont proposé l’utilisation de matériaux comme la pierre, le cuir... ».
« L’ambition initiale était de créer un double démonstrateur, combinant nouvelles technologies et collaboration entre métiers et étudiants divers », rappelle Yannick Ouvrard, le manager du M-Lab. Cette rencontre entre étudiants en sciences - qui calculent les pièces et pilotent les robots pour l’impression 3D - et artisans Compagnons du Devoir - travaillant le métal, le bois, la pierre et le cuir - a été « extrêmement enrichissante pour tout le monde », se réjouit-il.
Recyclage et impression 3D
Le pont intègre différents matériaux et technologies de fabrication, tels que le béton bas carbone, le thermoplastique, le bois ainsi qu’un alliage de mousse et de terre crue, qui a permis d’optimiser le moulage des pièces en béton. Ces dernières ont été réalisées à l’aide de moyens de fabrication numériques.
« Le béton que nous avons utilisé était déjà bas carbone et évidemment comme on est en impression 3D, on met le minimum de matière nécessaire au lieu de couler des gros morceaux de béton », explique Sébastien Le Loch.
Les pièces polymères, elles, sont des impressions robotisées en grande dimension, avec du polymère chargé en fibres de verre ou de carbone. Ces pièces rigides sont fabriquées à partir de pellets issus du recyclage de déchets de l’aéronautique.

« Nous avons récupéré des pellets issus des chutes d’Airbus à Nantes », rapporte Sébastien Le Loch.
Le procédé consiste à chauffer et fondre ces pellets grâce à une vis sans fin, dans une tête d’injection fixée au bout d’un robot. « La matière est ensuite déposée couche par couche, un peu comme une imprimante 3D classique ».
Pour le béton, le principe est similaire : « une pompe envoie le béton via un tuyau jusqu’au robot, qui dépose la matière exactement où on le souhaite ».
Des technologies déjà adoptées par l'industrie
Justement, juste à côté du pont, Élodie Paquet, chercheuse au département Génie Mécanique et Productique du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, manie un robot miniature pour montrer le procédé aux visiteurs d’Artibat. Elle explique : « ce stand a pour objectif de démontrer qu’il est possible d’adopter des procédés sobres et durables dans la construction, en utilisant des matériaux à faible empreinte carbone».
Selon elle, « l’impression 3D permet un gain de temps significatif par rapport aux méthodes traditionnelles de pose. Elle réduit également les déchets, car la matière est déposée uniquement là où elle est nécessaire ».

À l’avenir, ce genre de technique pourrait-elle être adoptée par les industries du bâtiment et les artisans ? « Pour l’impression béton, c’est déjà le cas, ces technologies ont franchi le cap de l’industrie », assure la chercheuse.
« En s’invitant à Artibat, ce pont illustre l’esprit du salon : créer des passerelles entre recherche, formation et professionnels », assure Valérie Sfartz, directrice générale du salon. Et de conclure : « Artibat, plus grand salon fédérateur de la construction en 2025, ne pouvait rêver plus bel ambassadeur de l’esprit de filière et de transmission ».
> Consulter notre magazine sur Artibat 2025
Propos recueillis par Nils Buschbaum