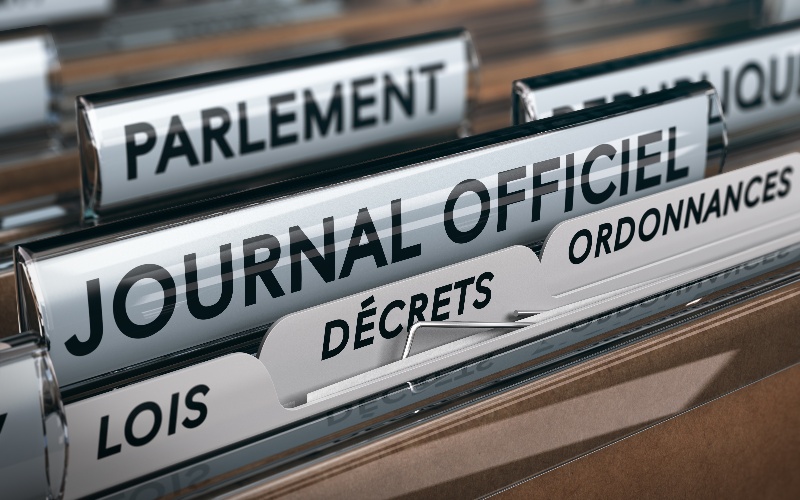Construire ou rénover, les bailleurs sociaux doivent arbitrer
Publié le 24 novembre 2025, mis à jour le 01 décembre 2025 à 16h50, par Virginie Kroun

La Banque des Territoires révèle dans une étude la difficulté pour les bailleurs sociaux à concilier construction et réhabilitation de leur parc. D’autant que la loi Climat et Résilience les contraint à l’éradication des passoires thermiques.
Une obligation pour des enjeux environnementaux, que le mouvement HLM encourage. « Les bailleurs ont toujours eu la préoccupation de la performance énergétique du parc. D'ailleurs on a globalement un stock de performance plus favorable que le parc privé », nous indique Marianne Louis, directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Or, « là où, avant, on pouvait fonctionner juste sur la production et se dire, s'il y a des opportunités, on fera des rénovations, maintenant, il faut que les deux soient inscrits dans une stratégie patrimoniale au même niveau », abonde-t-elle, en concluant : « Très clairement, aujourd'hui, il faut qu'on soit en situation d'apporter aux bailleurs de la visibilité sur le financement de la production et de la rénovation ».
Un arbitrage stratégique, comme financier
CDC Habitat, dont 80 % du parc est social, affiche une répartition assez claire entre réhabilitation et construction. 11 500 projets neufs de logements sociaux ont été réalisés en 2024, et 13 500 sont prévus en 2025. 11 200 logements sociaux ont été réhabilités en 2024 et 10 500 en 2025.
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique du parc social de CDC Habitat remontent au Grenelle de l’Environnement en 2008. « Depuis, nos consommations énergétiques ont diminué de 41 %. Nous sommes très en avance sur ces sujets-là, car nous n'avons plus que 0,6 % du parc en F et 6 % du patrimoine en E à traiter», expose Anne-Sophie Grave, présidente du directoire.
Pourtant, les 3 milliards d’euros par an prévus par CDC Habitat dans l’investissement social se partageront entre 25 % sur la réhabilitation et 75 % sur le neuf. « Une réhabilitation, et heureusement, coûte moins cher qu'une opération de construction nouvelle, puisque vous n'avez pas à refaire les fondations ou la structure du bâtiment. Le prix de revient d'un logement neuf en social va être de l’ordre de 180 000 euros. La réhabilitation représente 25 à 30 % d'un logement neuf en montant », justifie Mme Grave.
À l’échelle de 1001 Vies Habitat d’Île-de-France – région qui représente deux tiers du parc social du bailleur -, « construire ou rénover un habitat social n'est pas un dilemme, mais plutôt une équation de plus en plus complexe à mettre en œuvre», affiche son directeur Éric Madelrieux.
Ainsi, les arbitrages du bailleur francilien se font sur deux plans. D’abord stratégique, entre nécessité de construire pour « développer le logement social partout » et réhabiliter pour accompagner les politiques de logement et de transition énergétique, comme le confort des résidents.
Viennent ensuite les enjeux financiers, entre l’allocation des fonds propres – tirés de l’exploitation du parc social – et l’emprunt – dicté par les taux d’intérêts, notamment du livret A. À partir de ces éléments, « on se projette généralement sur ce qu'on appelle un plan à moyen terme, à 15 ans », nous confie M. Madelrieux.
Dernièrement, 1001 Habitats Île-de-France a préféré construire plutôt que réhabiliter, bien que 240 millions d’euros de fonds propres seront déployés sur ce poste de travaux, contre une centaine de millions dans le neuf. « Évidemment, la réhabilitation a toute sa place. Le patrimoine ne s'arrête jamais de vieillir, et les pathologies sont quotidiennes », concède le directeur de CDC Habitat Île-de-France.
Mais selon ses estimations : « Si l’on monte une résidence d'une ou deux étiquettes, l'investissement va être contenu entre 45 000 et 55 000 euros de fonds propres par logement. Mais si l’on travaille sur l'accessibilité, on est obligés d’installer des ascenseurs à l'intérieur, des panneaux photovoltaïques sur les terrasses. On arrive vite à 110 000 euros. »
D’un autre côté, pour « 190 000 euros, le logement neuf répond aux normes, est moderne, agréable et prêt à passer sans travaux, sans nouveau réinvestissement, les 20 prochaines années », compare-t-il.
Différentes stratégies selon le territoire et l’historique du parc
Autre argument d’Éric Madelrieux pour la construction : développer du logement social là où il n’y en a pas, en vertu de la loi SRU.
Mais justement, est-ce que les besoins sont les mêmes sur l’ensemble du territoire français ? Ce n’est pas le cas pour CDC Habitat. « Si vous prenez en exemple les territoires tendus, comme l'Île-de-France, qui concentre d’importantes demandes en logements sociaux, il y a une nécessité de construire et de rénover, comme dans toutes les grandes métropoles », développe Anne-Sophie Grave.
Dans le bassin minier dans les Hauts-de-France, CDC Habitat fait le choix de réhabiliter pour remettre aux normes des logements de mineurs. Pareil dans les départements ultramarins. La Guadeloupe ou la Martinique sont par exemple exposées à une décroissance démographique et à la nécessité d’adapter le logement au vieillissement de la population. Mais s’il y a bien un département où des logements sociaux neufs seraient nécessaires aux yeux de Mme Grave, c’est à Mayotte. Un territoire précaire, dont la reconstruction après le cyclone Chido est un chantier hors-norme.
En bref, construire ou rénover le logement social est une mosaïque, qui varie selon les régions, mais aussi l’historique du parc. Car tous les bailleurs sociaux ne sont pas égaux. «Ceux qui ont un parc plus récent sont moins soumis à cette question du E et du F. Ceux qui ont un parc plus ancien - et ce n'est pas de leur faute car le parc a été construit à l'époque où les normes étaient différentes -, ont des enjeux de rénovation beaucoup plus lourds », illustre Marianne Louis de l’USH.
Deux chantiers propices à des expérimentations
Mais de ces contraintes peuvent naître des postures et expériences pour répondre aux enjeux de performance énergétique. Par exemple, sur la réhabilitation du parc de CDC Habitat, on mise sur la production hors-site avec isolation incluse afin d’intervenir en site occupé. On essaie de réemployer des éléments sanitaires ou de garde-corps pour des enjeux de décarbonation. On déploie les raccordements aux réseaux de chaleur urbains, ou les mixtes énergétiques gaz/EnR.
Côté neuf, CDC Habitat tend à répondre à la RE2020, notamment sur le confort d’été et l'utilisation d'éco-matériaux. Le bailleur social veut aussi ajuster des habitats aux besoins d’aujourd’hui, à travers des loggias pour créer des espaces extérieurs. Deux tiers de ses constructions sont des F2 ou F3, pour répondre à la demande actuelle de petits logements.
Le recyclage foncier fait partie dorénavant des modes de production, dans l’objectif de diminution du rythme d’artificialisation des sols. C’est le cas par exemple du projet de reconversion de friches entre Thiais et Orly, qui s’étend sur 14 hectares dont 7 ha seront désimperméabilisés et renaturés. Le tout en proposant des logements sociaux, intermédiaires et libres, dans un quartier composé de commerces, d'espaces verts, d'écoles et de bureaux.
Mais le logement social neuf se bute à un obstacle : l’acceptabilité des élus, comme le déplore Éric Madelrieux, directeur de 1001 Vies Habitat Île-de-France : « Aujourd'hui, c'est aussi une des causes du ralentissement du nombre de mises en chantier, notamment en Île-de-France, où l’on est systématiquement attaqué, c'est assez effroyable. Et certains élus essayent de développer ce que j'appelle des produits de contournement, qui rentrent dans la catégorie logement social, mais ne sont pas vraiment du logement social. ».
Or en France, « les gens ne peuvent pas se loger dans le privé. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on loge quasiment 80 % de la population. Alors, à un moment donné, il va falloir trancher », soutient-il.
> Consulter notre magazine sur le logement social
Propos recueillis par Virginie Kroun