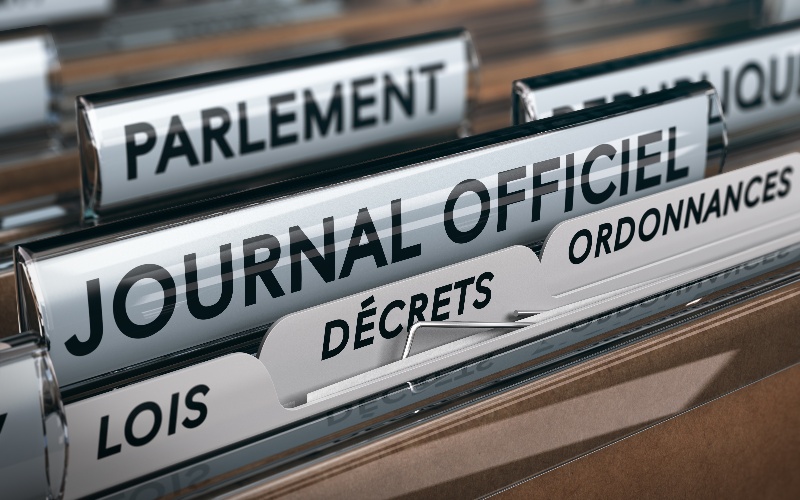Comment sont financés les logements sociaux ?
Publié le 24 novembre 2025, mis à jour le 01 décembre 2025 à 16h51, par Nils Buchsbaum

En pleine crise du logement, le vote du PLF 2026 ravive les débats autour du financement du logement social. Alors que le gouvernement Lecornu maintient le cap d’une politique d'austérité, l’Union sociale pour l’habitat (USH) alerte sur des prélèvements « record » imposés aux bailleurs HLM, susceptibles d’affaiblir leur capacité à construire, entretenir et rénover.
Une inquiétude d’autant plus vive que la demande explose : 2,8 millions de ménages étaient en attente d’un logement social au premier trimestre 2025.
L’USH plaide notamment pour une baisse durable de la réduction de loyer de solidarité (RLS). Instaurée en 2018, la RLS oblige les bailleurs à accorder aux locataires du parc social, sous condition de ressources, une réduction sur le loyer qu’ils paient. L'union souhaite également un renforcement des moyens du Fonds national des aides à la pierre (FNAP). L'établissement public, créé en 2016, est chargé de financer les opérations de création, rénovation et démolition dans le parc de logements locatifs sociaux.
En réaction à la présentation du PLF 2026 en octobre dernier, l’USH estime que si les mesures proposées étaient adoptées, les bailleurs sociaux perdraient 750 millions d'euros pour entretenir, rénover et construire. Les prélèvements prévus dans le PLF 2026 atteindraient, selon les calculs de l'organisme, un niveau record de 2,175 milliards d’euros.
Cependant, l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols) relativise les critiques portant sur la RLS. Selon ses responsables, si la baisse des loyers liée à la RLS a bien réduit le chiffre d’affaires des bailleurs sociaux, cette « pression financière » n’aurait pas été le seul frein à la production. L'agence souligne que d’autres obstacles pèsent également, comme l’accès au foncier, la délivrance des permis de construire ou la capacité de maitrise d’ouvrage des bailleurs sociaux. Il arrive aussi que certains élus ou associations locales opposent des resistances à la construction de logements sociaux.
Un siècle de logement social
Le parc social français compte aujourd’hui plus de 5 millions de logements et trouve ses origines à la fin du XIXème siècle, avec la création, en 1894, des premières sociétés de construction pour les logements ouvriers.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’urgence de reconstruction conduit l’État à mettre en place un système de financement des logements sociaux basé sur des aides à la pierre, des subventions et des prêts versés aux constructeurs.
En 1977, le Premier ministre Raymond Barre réforme ce dispositif. L’État se retire alors de la structuration de l’offre immobilière pour privilégier les aides personnelles destinées à corriger les effets du marché sur les ménages les plus vulnérables.
Cette réforme entraîne une baisse de la construction de logements et, dans un contexte de crise économique, les aides personnelles ne suffisent pas à compenser les difficultés d’accès au logement. Dans les années 1990, des aides fiscalessont créées pour encourager les investisseurs privés à développer le parc locatif.
71 % des ménages sont éligibles au parc social
Alors que la demande grimpe, la production, elle, s’essouffle. 82 000 logements sociaux ont été financés en 2023, le plus faible niveau depuis vingt ans.
Le parc social français se compose de logements soumis à différents plafonds de ressources, déterminés par le type de financement : les logements PLAI pour les ménages en grande précarité, les logements PLUS pour les locations HLM classiques, et les logements PLS attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM, mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé.
En 2023, la très grande majorité des logements sociaux (plus de 4,3 millions) sont des PLUS, environ 400 000 sont des PLAI et une part similaire des PLS.
Théoriquement, 71 % des ménages sont éligibles au parc social, mais en pratique, la majorité des logements (85 %) est soumise aux plafonds PLUS, accessibles à seulement 54 % des résidents.
L’emprunt, première source de financement
Les logements sociaux sont gérés par des bailleurs sociaux, également chargés de construire les logements sociaux.
Fin 2024, l’Ancols recensait près de 6 000 acteurs qui interviennent dans le secteur, dont 700 organismes de logement social (OLS) comme les offices publics, les entreprises sociales de l’habitat, les coopératives HLM ou les sociétés d’économie mixte. S’y ajoutent 9 entités collectant la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), comme Action Logement, et plusieurs milliers d’autres structures, associations, fondations ou collectivités territoriales, qui possèdent ou gèrent des logements locatifs sociaux ou des résidences sociales.
Pour financer la construction d’un logement social, un organisme mobilise trois types de ressources : ses fonds propres, des subventions d’autres institutions, et surtout des emprunts.
En 2022, 74 % du financement des nouveaux logements provenait d’emprunts, principalement auprès de la Banque des Territoires/Caisse des Dépôts, tandis que 16 % provenaient des fonds propres des bailleurs et 10 % de subventions publiques.
Les aides de l’État représentent 8,6 milliards d’euros, dont 63 % sous forme d’avantages fiscaux comme la TVA réduite, des exonérations de taxes foncières ou d’impôts sur les sociétés. S’y ajoutent 2,3 milliards de subventions d’investissement et environ 800 millions d’euros d’avantages de taux liés aux garanties d’emprunts assurées par les collectivités locales.
Le financement des logements sociaux repose aussi sur le système de Participation à l’Effort de Construction (PEC), autrefois appelé « 1 % logement ». Les entreprises financent le logement de leurs salariés soit en investissant directement, soit via des contributions à des collecteurs agréés.
Pour qu’une opération de financement et de construction de logement social soit validée, les loyers doivent respecter deux contraintes : rester en dessous des plafonds fixés par le prêt principal de la Caisse des Dépôts (PLAI, PLUS ou PLS) et permettre l’équilibre de l’opération pour rembourser les prêts contractés. Cela signifie que les loyers doivent couvrir pendant la durée du prêt principal, généralement autour de 40 ans, le remboursement ainsi que les coûts d’exploitation (gestion, entretien, taxe foncière).
Mais il existe en réalité quelques aménagements. Aux débuts de la constitution du parc social, les bailleurs ne disposaient que des ressources des constructions récentes, pour lesquelles ils devaient rembourser les emprunts. Aujourd’hui, ces emprunts étant remboursés, les loyers continuent de générer des ressources qui peuvent financer de nouvelles opérations, si bien que l’équilibre financier strict d’une opération n’est plus un critère absolu pour l’octroi de crédits, la situation globale du bailleur étant également prise en compte.
Produire 110 000 logements par an pour faire face à la demande
Dans son « panorama du Logement social 2025 », l’Ancols expose qu’en 2023, l'ensemble des bailleurs se trouve plutôt dans une bonne situation financière. Le chiffre d’affaires des bailleurs sociaux s’élève à 30,5 milliards d’euros, dont près de 18 milliards de coûts liés à l’activité, principalement pour la gestion des logements.
Les investissements atteignent 24,7 milliards d’euros. Près de 30 % de cette somme est consacrée à la réhabilitation. Sur cinq ans, ces investissements ont permis la mise en service d’environ 330 000 logements sociaux et 20 000 logements intermédiaires.
Pour autant, cette production reste insuffisante pour répondre à une demande qui ne cesse d’augmenter, accentuée par la chute de la construction privée, les fortes tensions sur le marché locatif et le coût élevé du foncier dans certaines zones. En 2024, 85 000 logements sociaux ont été construits, mais une seule demande sur sept a pu être satisfaite.
L’USH estime qu’il faudrait viser 110 000 logements sociaux par an pour répondre aux besoins et appelle l’État à accroître les subventions, afin de permettre la construction de logements supplémentaires dans les années à venir.
> Consulter notre magazine sur le logement social
Par Nils Buchsbaum