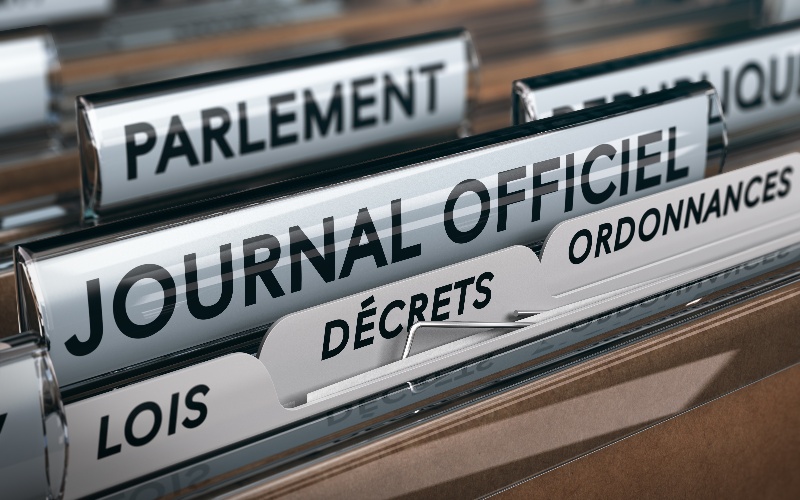Face au grand froid, Sites préconise le diagnostic des routes et voies ferrées
Avec les températures négatives, l'hiver peut être propice à des dégradations des infrastructures utilisées par les transports. Pour prévenir les dilatations de matériaux et autres apparitions de fissures, l'entreprise Sites propose de prendre des dispositions en amont.