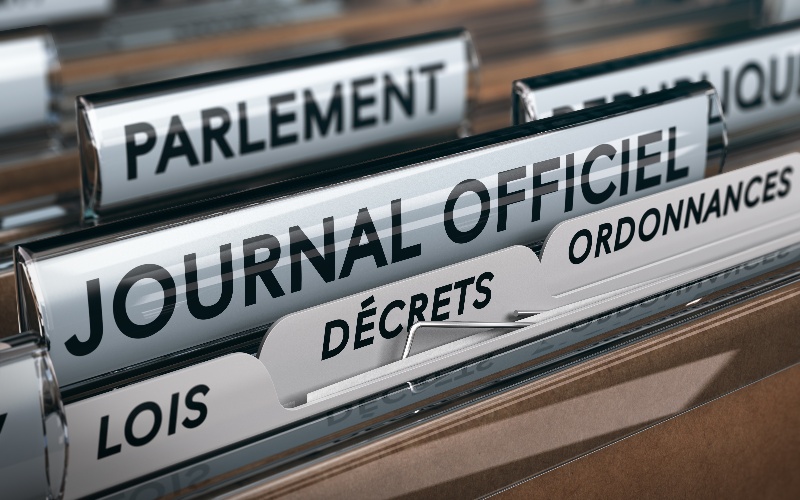Climat : l’adaptation passe d’abord par le bâtiment
Publié le 16 septembre 2025, mis à jour le 16 septembre 2025 à 11h11, par Camille Decambu

Réchauffement climatique : pourquoi la première ligne de défense passe par… nos bâtiments
À mesure que la France se réchauffe et que les événements climatiques extrêmes se multiplient, l’endroit où l’on vit devient la première barrière — ou la première faiblesse. Les données officielles de Météo-France, Santé publique France, du Cerema et de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) convergent : adapter les logements et, plus largement, le parc bâti, est un chantier prioritaire de la résilience nationale.
Vagues de chaleur : un risque sanitaire massif
Les projections de Météo-France sont claires : dans une France à +2,7 °C dès 2050, les vagues de chaleur pourraient s’étendre de début juin à mi-septembre ; à +4 °C en 2100, elles pourraient durer jusqu’à deux mois d’affilée. Déjà aujourd’hui, les effets sont lourds : l’été 2023 a causé plus de 5 000 décès attribuables à la chaleur, dont plus de 1 500 durant les épisodes de canicule. Depuis 2014, Santé publique France observe entre 1 000 et 7 000 décès supplémentaires chaque été selon l’intensité des chaleurs.
2024 figure encore parmi les années les plus chaudes jamais observées, au 4ᵉ rang depuis 1900. Ces chiffres expliquent pourquoi le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3) met l’habitat au cœur de sa stratégie.
Érosion et sécheresses : des logements fragilisés
Le Cerema a chiffré les menaces du recul du trait de côte : 5 200 logements et 1 400 locaux d’activité pourraient être affectés d’ici 2050, soit près de 1,2 milliard d’euros de valeur. Dans un scénario pessimiste à l’horizon 2100, ce sont 450 000 logements qui seraient exposés.
Autre phénomène, le retrait-gonflement des argiles (RGA), accentué par les sécheresses, fissure des milliers de maisons. Le ministère de la Transition écologique estime le coût moyen d’un sinistre sécheresse à 21 000 € par maison entre 1990 et 2015. Face à ce risque, une aide préventive expérimentale pour les propriétaires en zones fortement exposées vient d’être annoncée.
Le bâtiment, première ligne de défense
La réglementation intègre désormais ces risques. La RE2020 impose un indicateur de confort d’été (degrés-heures d’inconfort) qui oblige à prévoir protections solaires, inertie thermique, ventilation naturelle ou, si nécessaire, recours au froid.
Mais l’adaptation dépasse le cadre réglementaire :
- Ombrage (volets, brise-soleil, végétalisation) avant d’ajouter du froid artificiel.
- Ventilation nocturne pour évacuer la chaleur accumulée.
- Inertie et isolation adaptées, façades claires, désimperméabilisation des cours.
- Gestion des eaux pluviales pour prévenir les sinistres liés aux sols argileux.
- Planification locale dans les zones littorales menacées.
Un investissement massif mais nécessaire
Selon l’I4CE, l’adaptation du parc bâti nécessitera :
- 1 à 2,5 milliards d’euros par an pour la construction neuve,
- 4 à 5 milliards d’euros par an pour la rénovation.
Des sommes importantes, mais qui représentent une fraction des coûts évités en matière de santé publique, de sinistres et de réparations.
En 2025, l’État consacre 1,7 milliard d’euros directement à l’adaptation (fonds vert, Agences de l’eau, prévention des risques), mais une grande partie des dépenses liées à la rénovation et aux infrastructures contribue indirectement à la résilience. L’enjeu, selon I4CE, est d’intégrer systématiquement l’adaptation dans chaque flux d’investissement : rénovation énergétique, ANRU, écoles, hôpitaux, logement social.
Cinq chiffres à retenir
- +2,7 °C en 2050 : vagues de chaleur de début juin à mi-septembre.
- > 5 000 décès liés à la chaleur en 2023.
- 5 200 logements menacés par l’érosion d’ici 2050 ; 450 000 en 2100.
- 21 000 € : coût moyen d’un sinistre sécheresse par maison.
- 4–5 milliards €/an : besoins pour adapter la rénovation aux futures chaleurs.
En synthèse
Si l’on hiérarchise par utilité sociale immédiate, le logement est le premier front de l’adaptation. C’est lui qui protège la santé lors des canicules, concentre une part des dommages structurels (sécheresse, littoral) et représente des flux d’investissement massifs où l’on peut intégrer des solutions dès aujourd’hui, à coût maîtrisé si elles sont pensées en amont.
L’adaptation des bâtiments n’est donc pas un « plus » facultatif : c’est un pilier de la sécurité et de la résilience face au changement climatique.
Sources : Météo-France, Santé publique France, Cerema, ministère de la Transition écologique (PNACC3, RE2020, RGA), I4CE.
Par Camille DECAMBU