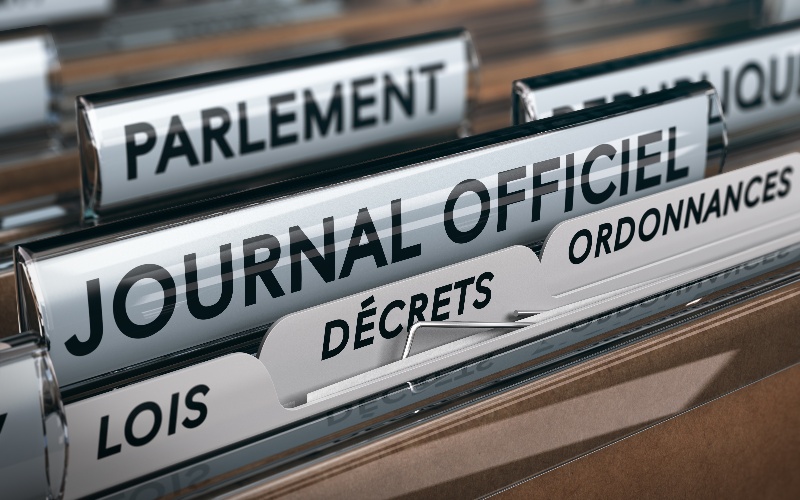Les villes prêtes à se mettre « au service de la transition écologique »
Publié le 20 octobre 2025, mis à jour le 21 octobre 2025 à 9h56, par Raphaël Barrou

Tout est parti d'un courrier envoyé courant septembre par Sébastien Lecornu à l'attention des maires. Le Premier ministre y signalait son intention de lancer un « grand acte de décentralisation » de manière à « garantir un service public efficace, de proximité ». L'objectif étant de déposer un projet de loi en décembre, soit quelques mois avant les élections municipales.
« Tous les éléments financiers et réglementaires sont prêts », selon la présidente de l'association France urbaine
Les élus locaux avaient jusqu'au 31 octobre pour lui transmettre leurs propositions. Lors du congrès annuel de l'association France urbaine, qui représente les grandes collectivités et métropoles françaises, ces derniers ont demandé à Sébastien Lecornu que cette « nouvelle étape de décentralisation (...) soit mise au service de la transition écologique ».
« Tous les éléments financiers et réglementaires sont prêts (...) pour devenir demain autorités organisatrices de la transition écologique (...) parce qu'on parle économie décarbonée, politique de mobilité, projets alimentaires de territoire, rénovation énergétique de nos logements », a argumenté Johanna Rolland, présidente de l'association.
France urbaine a aussi proposé de formaliser cette mission en nommant les territoires urbains comme Autorités organisatrices de la transition écologique et solidaire (AOTES).
Une mise à contribution « injuste » des grandes villes
La maire PS de Nantes a toutefois averti qu'une nouvelle vague de décentralisation sans autonomie financière et fiscale serait « un échec ». « Comment se projeter sincèrement vers une extension des responsabilités locales avec une forme d'épée de Damoclès budgétaire en permanence au-dessus de nos têtes ? », a-t-elle interrogé.
L'association conteste la mise à contribution des grandes villes et intercommunalités dans le projet de budget pour 2026, qu'elle juge « disproportionnée et injuste » pour les grands territoires urbains, tant sur le plan du volume que dans les modalités d'application.
« Nous souffrons parfois (...) d'une caricature aussi injuste qu'inexacte qui voudrait que l'urbain soit synonyme seulement de prospérité et d'abondance alors que (...) deux tiers des personnes pauvres vivent dans nos villes », a plaidé Johanna Rolland, dénonçant une « politique d'assèchement des ressources locales ».
→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.
Par Raphaël Barrou