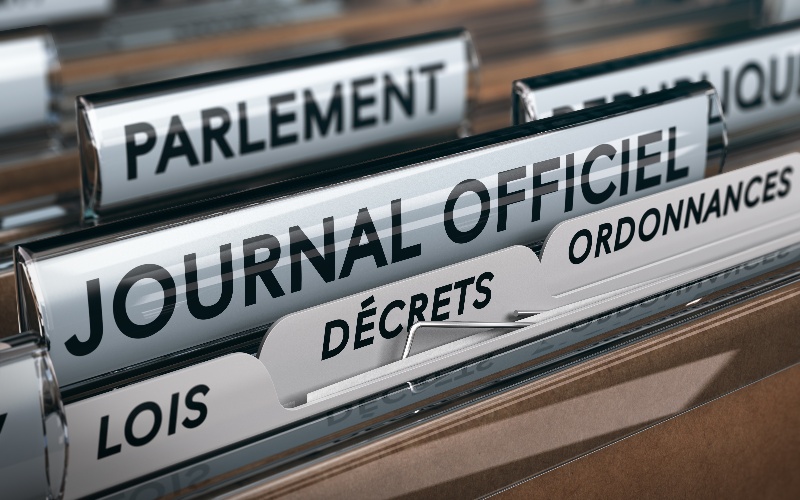Scolytes, termites et mérule : quelles menaces pour la construction bois ?
Publié le 01 octobre 2025, mis à jour le 06 octobre 2025 à 17h49, par Virginie Kroun

Si le bois est sur le devant de la scène construction, des espèces naturelles peuvent impacter ses qualités, tant techniques qu’esthétiques. Focus sur trois d’entre elles.
Des carences réglementaires contre la mérule
Commençons par la mérule, ce champignon qui se développe dans les recoins confinés, mal ventilés et à l’abri de la lumière. Sa propagation se déclenche dès un certain taux d’humidité dans le bois, estimé à partir de 20 %. Il peut entraîner de forts dégâts structurels et s’accompagne de moisissures impactantes d’un point de vue sanitaire (asthme, problème respiratoire, etc...).
« On en retrouve particulièrement dans les zones humides, les maisons abandonnées ou inoccupées une majeure partie du temps », nous détaille Marie-Laure Ribette, chargée de mission Unité technique qualité et Règles de la construction au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). Son équipe est chargée de cartographier les zones touchées par le champignon, à partir des déclarations municipales.
« Les premiers cas de mérule se trouvaient surtout dans la Somme, la Seine-Maritime, le Calvados. Mais il y en a aussi en Corrèze, dans le Puy-de-Dôme, dans la Haute-Loire », poursuit-elle.
Cependant, « avec le vent, les spores s’envolent. J'ai par exemple un ami qui avait détecté la mérule dans son local à Lyon », témoigne François Brinon. Le dirigeant dela société Protechbois, spécialisée dans le traitement bois à Quimper (Finistère), craint d’ailleurs un risque d’épidémie dans les maisons neuves.
Équipées de pare-vapeur ou de fenêtres bien jointées, « plus les maisons seront étanches à l'air, plus il y aura des problèmes de pathologie du bois», avertit le professionnel.
« À ce jour, la réglementation concernant ces champignons lignivores relève d’un arrêté préfectoral. Dans les communes concernées par cet arrêté, un diagnostic mérule est obligatoire lors de la vente d’une maison. En revanche, aucun texte n’impose un traitement systématique. Bien entendu, en cas de danger pour les riverains ou en centre-ville, le maire peut user de son pouvoir de police pour contraindre le propriétaire à réaliser des travaux d'éradication », nous confie Mme Ribette.
D’autant que différents niveaux de traitement existent dans le cas de la construction. Le bois neuf - en particulier le sapin - est trempé dans des bains insecticides et fongicides. Mais lors du découpage, pour des charpentes par exemple, une protection complémentaire doit être appliquée.
On peut procéder par injection tous les 30 centimètres en quinconce « mais l'imprégnation n'est pas parfaite », selon François Brinon, surtout sur les zones d’empochement et du bois dur, comme le chêne ou le châtaigner. Sinon, il y a la pulvérisation de produits certifiés, dont le gel de la marque Xilix, qui pénètre le bois sans perçage, qu’il soit feuillu ou résineux.
Le termite, un risque qui se déplace
« Quand on a commencé à vouloir instaurer une réglementation sur la mérule, cela a été très problématique parce que la mérule était passée sous silence. Il ne fallait absolument pas en parler, car la mentionner dévalorisait le bien », nous indique l’experte du Cerema. « Les législateurs ont avancé vraiment très doucement là-dessus. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'obligations », complète-t-elle.
Sûrement car la mérule ne profilère pas comme les termites. Ces insectes xylophages sont particulièrement présents dans les départements du Sud-Ouest (Landes, Gers, Haute Garonne), mais aussi plus au nord (Loire-Atlantique, Sarthe).
« Depuis plusieurs années, on constate que les termites progressent sur le territoire. Le changement climatique favorise aussi leur progression. Quand les termites ne trouvent plus de nourriture, ils essaiment ailleurs », précise Mme Ribette.
Les constructions neuves situées dans les communes sous arrêté préfectoral sont soumises à un traitement anti-termite. Dans ces mêmes communes, les propriétaires vendant un bien immobilier doivent fournir un diagnostic termite. Les nouveaux cas de découverte de termite doivent être déclarés en mairie avec un imprimé CERFA spécifique.
«L'idéal, ce serait que tout le territoire - ou au moins une grosse partie - soit sous arrêté préfectoral », estime l’experte du Cerema, pour une meilleure appréhension du risque termite, connu pour ravager les structures bois.
Côté traitement, l'institut FCBA mène des essais, dans le cadre de la norme NF EN 117. Cette dernière tend à déterminer le seuil d’efficacité des produits contre les termites européens. Une autre recherche sur la norme XP/NF X41-543 va dans ce sens également, avec des critères d’évaluation définis et des essais en temps réel.
De la possibilité de construire avec du bois scolyté
Que dire également des scolytes, ces insectes à larves xylophages de deux à sept millimètres, qui se nichent sous l’écorce des arbres pour pondre et se répandre ? Selon Marie-Laure Ribette, une seule réglementation existe et « impose un traitement à la construction. Tous les départements métropolitains sont concernés ».
Déclenchée en région Grand-Est en 2018, l’épidémie s’est propagée dans la moitié nord de la France (Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Normandie) comme dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Le tout sous le joug du changement climatique, car la sécheresse affaiblit les arbres, les rendant moins résistants face à ces attaques.
Mais le livret «Pourquoi il faut utiliser du bois scolyté en construction», publié par l’Office national des forêts (ONF), montre queles scolytes impactent les qualités esthétiques du bois, mais pas forcément celles constructives.
« Si le bois scolyté prend une coloration bleu-gris, il conserve toutefois ses qualités mécaniques », illustre Valérie Metrich-Hecquet, directrice générale de l'ONF, dont le siège national a été construit avec de l’épicéa scolyté.
Un protocole de caractérisation, mené par FCBA et financé par l’Ademe, a comparé différents épicéas : sains, frais légèrement scolytés, scolytés depuis longtemps, « scolytés secs », voire morts sur pieds.
« À l’issue de ces expérimentations, le bilan était clair : le bois scolyté est utilisable en construction, qu’il s’agisse de bois massif ou de bois collé. Bien sûr, à l’étape du sciage, on perd forcément un peu de rendement, entre 10 et 15 % par rapport à du bois non-attaqué, mais cela concerne seulement les épicéas très secs. C’est une perte surmontable », détaille Nathalie Mionetto, chargée du territoire Nord-Est à l’institut technologique.
Attaqué seulement sur la première couche, le bois scolyté présente une résistance et une compression similaires à celles d’un bois sain. Il est donc utilisable pour la charpente, les bois-collés comme ceux d’ingénierie.
D’ailleurs, son aspect bleui peut intéresser certains designers. Pour les moins convaincus, « nous allons pousser encore plus loin nos recherches afin de prouver qu’une fois le bois séché, le champignon responsable du bleuissement du bois ne se développe plus », souligne Mme Mionetto.
> Consulter notre magazine sur la construction bois
Propos recueillis par Virginie Kroun