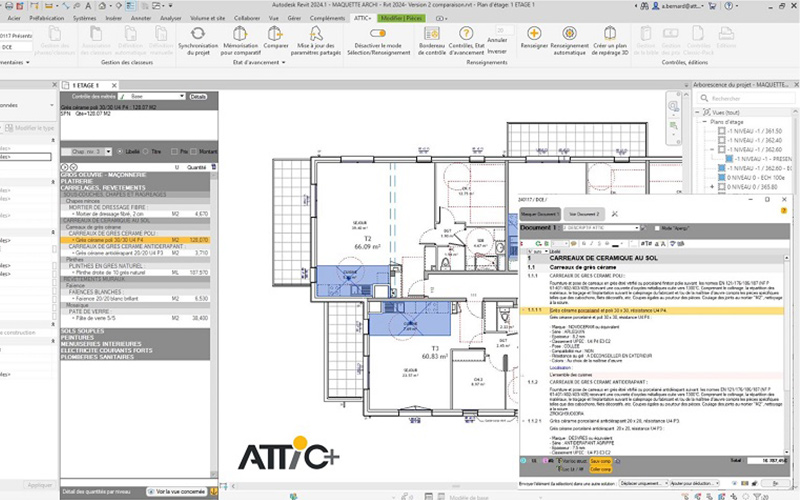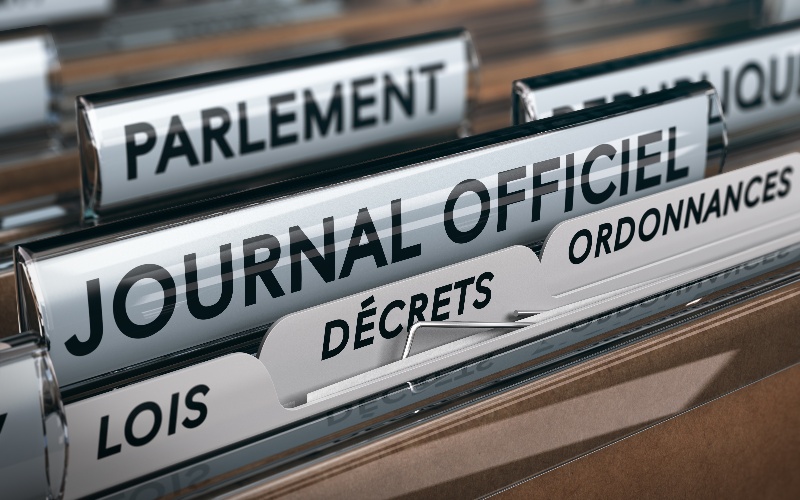La construction en bois, vers un avenir durable ?
Publié le 01 octobre 2025, mis à jour le 06 octobre 2025 à 17h43, par Sipane Hoh

Les secteurs de la construction et de l’immobilier, responsables d’une part significative des émissions de gaz à effet de serre (GES), évoluent vers des pratiques plus durables. La transition écologique, désormais au cœur des politiques publiques et des stratégies industrielles, vise à réduire l’impact environnemental. Face à divers défis, les architectes innovent.
Il existe un matériau millénaire utilisé depuis toujours, le bois, qui refait surface. Les bénéfices de cette matière naturelle ne sont plus à démontrer, qu’en pensent les architectes ainsi que les professionnels ? La construction en bois doit-elle gagner encore plus du terrain ? Les architectes nous donnent leurs avis.
Les avantages de la construction bois
L’urbanisation mondiale connaît une croissance exponentielle, augmentant ainsi la demande en logements, infrastructures et bâtiments commerciaux. La pression sur les ressources et les territoires est de taille. Face à cette croissance, certains architectes trouvent qu’il est nécessaire de repenser nos modes de construction pour répondre aux enjeux de durabilité et de réduire l’empreinte carbone des bâtiments.
L'utilisation du bois en architecture présente de nombreux avantages, tant sur le plan écologique que technique et esthétique. La fabrication et la construction en bois émettent moins de CO₂ que celles utilisant d’autres matériaux.
Le bois possède d’excellentes propriétés isolantes, ce qui permet de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Il est léger et facile à couper ou à assembler. En fonction des projets, le bois peut être une solution économique, notamment grâce à la rapidité de construction.
L’architecte doctorante Margotte Lamouroux qui, dans sa thèse, cherche à comprendre le rôle des architectes dans le développement de la filière bois-construction, souligne qu’un projet en bois « nécessite plus de temps d’étude pour à priori moins de temps d’exécution. Les architectes qui optent pour la construction bois retrouvent une pensée constructive car ils réfléchissent aux assemblages ».
De même, il s’agit de nouvelles méthodes de travail à mettre en place, à trouver le compromis entre réglementation et coût de construction.
Les techniques de la construction en bois
La construction en bois offre une grande diversité de technicités selon la nature de chaque projet. Utilisée principalement pour les toits des maisons individuelles ou des bâtiments agricoles, la charpente traditionnelle et l’ossature bois consistent en l’assemblage de pièces de bois, souvent en bois massif.
Il s’agit d’une technique au « coût modéré où le bois est scié mais sans être transformé », rappelle Margotte Lamouroux, qui donne l’exemple de plusieurs projets remarquables dont « Bois Debout », l’immeuble en bois massif réalisé par Stéphane Cochet, comme architecte mandataire en collaboration avec A003 architectes, BGA architecture et B. Garnier architecte associé.
Situé à Montreuil, l’ensemble de six niveaux est composé de 17 logements sociaux et 2 locaux d'activités avait reçu plusieurs certifications comme le Passiv Haus, Cerqual/Qualitel H&E profil A et le label bâtiment bio sourcé niveau 1.
Les murs en ossature bois utilisés dans la construction de logements collectifs ou des bâtiments tertiaires mettent en avant une grande rapidité de mise en œuvre doublée d’une isolation renforcée et d’une légèreté permettant de réduire la fondation.
Par ailleurs, les bois lamellé-collé est utilisé pour les structures architecturales complexes dans des bâtiments résidentiels ou commerciaux, mais aussi pour fabriquer des éléments de façade et des portes entre autres. Les panneaux préfabriqués en CLT (Cross Laminated Timber) sont utilisés, quant à eux, pour les structures, les sols ainsi que les murs.
Néanmoins, le coût d’une telle technique est conséquent et les chutes sont nombreuses et pas toujours optimisées. Par ailleurs, les architectes peuvent également croiser les techniques comme par exemple le projet ÉCRIN de l’agence d’architecture CALQ. Réalisé à Mauxins, le projet propose la création d'un immeuble d'habitation de 14 appartements sur 6 niveaux où les architectes ont opté pour une structure en bois, (excepté le noyau qui est en béton). Le tout complété par des murs de façades réalisés en MOB (Mur à Ossature Bois) et des planchers en dalles O’portune®. Un procédé constructif innovant en bois développé par CBS-Lifteam, qui leur a permis d’atteindre de hautes performances.
Peu importe finalement la technique, la question qu’il faut poser lors d’une utilisation selon Margotte Lamouroux concerne l’économie de la matière. La chercheuse donne l’exemple des réalisations du Studio Lada, où l’architecte Christophe Aubertin change parfois la donne et utilise des petites sections de bois, une manière d’engendrer des formes savantes et complexes. « C’est une écriture architecturale qui résulte de la volonté de ne pas utiliser le bois transformé, qu’a aussi beaucoup utilisé l’ingénieur Jacques Anglade », conclut l’architecte.

Les défis de la construction en bois
Malgré ses nombreux avantages, la construction en bois doit relever certains défis comme par exemple la résistance aux insectes et à l’humidité. L’un des paramètres importants réside dans la réglementation et les normes, qui peuvent varier d’un pays à l’autre.
Le risque d’incendie est un autre inconvénient comme les coûts, la disponibilité ou encore les contraintes techniques. Ce nécessite des formations spécialisées pour une meilleure mise en œuvre des compétences spécifiques, notamment pour l’assemblage, la préfabrication, et la gestion des ponts thermiques. Sans compter la promotion et la gestion durable des forêts pour un impact positif sur la biodiversité.
Loïc Daubas, l’un des fondateurs de l’Atelier Belenfant Daubas avertit sur l’importance de l’approvisionnement et se préoccupe de la question des ressources. Selon l’architecte, «les plantations de douglas et autres essences de bois sont des dispositifs qui acidifient à terme les sols ».
C’est pourquoi, « il faudrait se pencher sur des moyens moins impactants pour l’environnement ». Par exemple, la futaie irrégulière - où cohabitent des petits et des grands arbres, des jeunes ou des moins jeunes, des végétaux de tailles diverses - préserve la stabilité paysagère de la forêt.
Il s’agit aussi d’un lieu où des arbres sains ou malades sont coupés progressivement avec parcimonie. Cependant, «préserver l’existant sans dénaturer nécessite plus de temps et d’intelligence, il s’agit de prélèvements chirurgicaux qui n’abîme pas le sol ».
L’utilisation du bois non-traité devient une gageure, car certaines régions ont imposé le bois traité à cause de la présence des termites.
De même, qui dit chantier en matériaux biosourcés comme le bois, dit plus de risques. « Il faut être plus attentif au stockage en phase chantier mais aussi en phase finissage » précise le fondateur de l’Atelier Belenfant Daubas, qui rajoute : « Le permis de feu est aussi plus exigeant, quant au risque de l’eau c’est un véritable problème ».
Comment faire pour continuer une construction en bois sous la pluie ? « Contrôler l’humidité fait aussi partie des aléas de la vie d’un chantier en bois ».
Pour répondre favorablement à l’augmentation de l’usage du bois dans la construction, la « sanctuarisation de la paroi », c’est-à-dire, la protection du feu du mur périphérique en ossature bois et isolation biosourcée s’impose aux architectes. Des procédés qui complexifient le recours à la construction bois.
Par ailleurs, Loïc Daubas souligne qu’il faut construire avec les ressources disponibles et non pas l’inverse. Pour cela, les idées et concepts du départ ne peuvent pas être figées mais sont évolutifs. Ce phénomène engage la discussion au sein de la filière. Charpentier, scieur, architectes peuvent ainsi échanger pour trouver les meilleures solutions. « N’oublions pas que toute l’histoire de l’architecture se base sur les ressources », conclut l’architecte.
Quelques exemples de chantiers qui utilisent le bois
Le projet de Wikivillage est un projet vertueux. Initialement pensé par le collectif AAA, ETIC & REI Habitat dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris », l’ensemble a été rénové en collaboration avec DVVD Architectes & Ingénieurs. Wikivillage a été conçu dans une démarche limitant les déchets et une stratégie bas-carbone sur toute sa durée de vie.

Majoritairement construit et aménagé avec du bois local - issu de forêts françaises gérées durablement, certifiées PEFC ou FSC, dans un périmètre de 350 km - permettant le stockage de CO2, de la structure au mobilier intérieur. Il a notamment un objectif de consommation énergétique six fois moindre, que la moyenne des bâtiments tertiaires en France grâce à de nombreux procédés. L'ensemble recourt à des matériaux biosourcés, aux panneaux photovoltaïques, à la pompe à chaleur air-eau, aux toilettes sèches, au système de refroidissement naturel de l’air, ainsi que d’autres astuces qui font de ce projet un exemple en soi.
Dans le but d’enrichir l’offre culturelle et artistique, la commune de Plescop a décidé de conserver le bâtiment historique de l'ancienne école privée Sainte-Anne et d’y greffer un espace culturel. Le projet a été confié à l’agence d’architecture nantaise Guinée*Potin qui a réalisé une salle de spectacle, une école de musique, un espace jeunesse, un hall tiers-lieu ainsi que des locaux associatifs.

Pour ce faire, les architectes ont conçu un volume bas qui vient se greffer sur l’existant. Le mur-rideau alu de teinte grège est coiffé d’un bandeau en bois. Il offre ainsi une liaison transparente entre l’école rénovée et la nouvelle salle de spectacle. Le toit de cette dernière est à double pente avec une couverture acier, une ossature bois ainsi que des teintes sombres. Outre ses qualités bioclimatiques, l’ensemble met le bois à l’honneur, en structure, bardage, doublage intérieur, mobilier, isolation, et même le chauffage !
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Pirmil-Les-Isles dans la métropole nantaise, l’Atelier du Rouget Simon Teyssou & associés et l’Atelier Belanfant Daubas, associés au groupe CIF, ont été retenus pour la conception d'un projet ambitieux et vertueux. Le but : constituer un ensemble d’îlots situés sur la commune de Rezé. L’îlot octroyé à l’Atelier du Rouget et l’Atelier Belenfant Daubas sera constitué de cinq bâtiments qui favorisent l’emploi des ressources locales comme par exemple le bois de la forêt du Gâvre ou encore la paille et le chanvre de la région.

Petitdidierprioux architectes réalise à la lisière du bois de Satory, dans un lieu paysager et privilégié, un projet qui prend ses racines dans son environnement. Il s’agit d’un programme d’habitat social qui prend place sur le site d’une ancienne résidence sociale datant des années 60, où l’utilisation du matériau bois trouve sa signification.

À la manière d’un grand corps de ferme, plusieurs volumes se juxtaposent et s’organisent autour d’une cour intérieure arborée. L’ensemble résulte d’une réflexion sensible sur la manière de composer avec l’existant, tout en engendrant une architecture intemporelle.
Le choix des architectes s’est porté sur le bois car selon eux : « construire en lisière de forêt, sur un sol humide et vivant, impose un système constructif adapté. Ici, le bois s’impose naturellement : à la fois pour sa performance, sa chaleur, et sa capacité à s’inscrire dans son environnement ».
De ce fait, cette matière millénaire a été utilisée en façade mais aussi en structure, à la fois visible et tangible, elle garantit un logis simple et pérenne. Tandis que le rez-de-chaussée est réalisé en béton coulé en place et protégé par une lasure minérale, les étages courants sont conçus en façade ossature bois (FOB) en épicéa et exosquelette en mélèze brut. La vêture de la façade est en sapin prégrisé, un matériau qui anticipe l’évolution naturelle de la matière pour une meilleure cohérence avec la teinte de la tuile.
L’utilisation du bois est non seulement architecturale, décorative ou esthétique mais il s’agit d’une réponse réfléchie à une condition de vie, un exercice que l’agence Petitdidierprioux architecte a réussi avec brio.
Perspectives d'avenir
L'architecture en bois connaît un essor croissant grâce à ses nombreux avantages écologiques, techniques et esthétiques. Le développement futur du bois pourrait participer à la réduction de l’empreinte carbone et la réalisation de bâtiments performants et vertueux.
De même, la préfabrication en usine réduit les délais, les coûts et la consommation des ressources, facilitant la réalisation de projets complexes. Le bois s’intègre de plus en plus dans des projets urbains, avec des tours en bois, des quartiers écologiques, ou encore des infrastructures publiques.
Côté réhabilitation, le bois offre une multitude de possibilités de transformation rapide de bâtiments existants, en respectant l’environnement.
Aujourd’hui, des bâtiments de grande hauteur en bois voient le jour. La souplesse du bois permet la réalisation de formes architecturales audacieuses, modernes et chaleureuses. Les perspectives d’avenir pour l’architecture en bois sont prometteuses et portées par la recherche technologique.
Le bois apparaît comme une solution clé pour bâtir un avenir plus durable, esthétique et innovant. Pour Margotte Lamouroux, retrouver le sens des matériaux, développer les filières régionales et construire avec les ressources environnantes constitue l’une des leviers d’avenir concernant la construction en bois.
> Consulter notre magazine sur la construction bois
Propos recueillis par Sipane Hoh