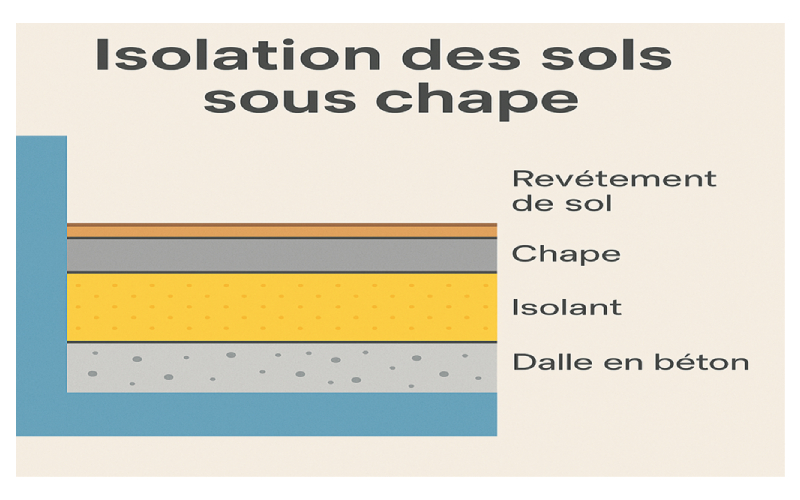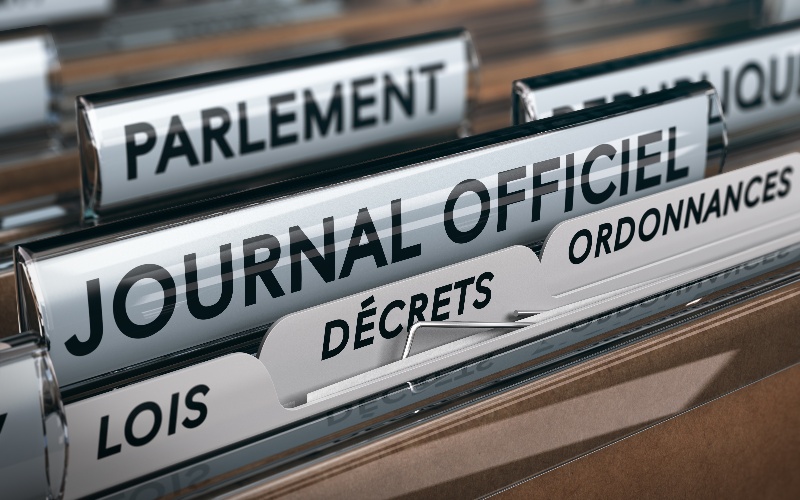Isolation des murs enterrés : comment limiter les déperditions thermiques ?
Publié le 18 novembre 2025, mis à jour le 18 novembre 2025 à 11h20, par Camille Decambu

Pourquoi isoler les murs enterrés ?
Souvent présents dans les sous-sols, caves, garages, ou rez-de-jardin semi-enterrés, les murs de soubassement sont exposés à l’humidité du sol et aux variations de température. En hiver, la chaleur intérieure s’échappe vers le sol plus froid, entraînant des déperditions thermiques importantes.
Isoler des murs enterrés présentent 4 avantages majeurs :
- La réduction des pertes de chaleur : jusqu’à 20 % des pertes thermiques peuvent provenir des murs en contact avec le sol.
- L’amélioration du confort : un mur enterré non isolé peut provoquer une sensation de froid ou d’humidité dans les pièces attenantes.
- La prévention de l’humidité : une bonne isolation, associée à un système d’étanchéité, limite les remontées capillaires et la condensation.
- La valorisation du bien : un logement bien isolé est plus performant sur le plan énergétique (DPE) et prend de la valeur sur le marché immobilier.
Comment isoler un mur enterré ?
Pour des raisons de performance, il est conseillé d’isoler les murs enterrés par l’extérieur. Si cette méthode s’applique particulièrement bien aux constructions neuves, elle peut s’avérer plus fastidieuse, voire impossible, lors de travaux de rénovation. Il est alors recommandé d’opter pour une isolation par l’intérieur. Que vous optiez pour l’une ou l’autre solution, il faut généralement compter entre 50 et 150 euros par m² isolé. Le tableau ci-dessous présente les différents avantages de ces deux types d’isolation.
| Type d'isolation | Avantages | Inconvénients |
| Isolation par l'extérieur |
|
|
| Isolation par l'intérieur |
|
|
L’isolation extérieure d’un mur enterré
Lors d’une isolation par l’extérieur (ITE), l’isolation sous enduit est la technique la plus répandue. Cela s’explique par deux raisons. Tout d’abord, elle est relativement simple à mettre en œuvre. Elle bénéficie en plus du meilleur rapport qualité prix.
L’isolation sous enduit consiste à fixer des panneaux isolants rigides, souvent en polystyrène expansé (PSE), sur les murs extérieurs. Vous pouvez également utiliser des isolants minéraux ou des isolants naturels. Les types de matériaux utilisés peuvent varier, ce qui en fait une solution flexible et adaptable.
Généralement, les professionnels recommandent trois types de matériaux :
- Le polystyrène extrudé (XPS) : très résistant à l’humidité, compressible, bonne performance thermique.
- Le polyuréthane (PU) : excellent isolant mais plus cher.
- Les panneaux isolants spécifiques pour soubassement.
Une couche de sous-enduit hydraulique est ensuite appliquée pour apporter l’étanchéité à la façade ainsi que pour renforcer les murs et prévenir des fissures.
L’isolation intérieure d’un mur enterré
L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) consiste à poser un matériau isolant sur la face intérieure des murs. Cette technique est utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.
Deux procédés existent pour réaliser une ITI :
- L’isolation intérieure avec doublage sur ossature : l’isolant est inséré entre les montants d’une structure en métal ou en bois recouvert d’une plaque de plâtre ou d’un lambris.
- L’isolation intérieure par doublage collé : un revêtement de finition dans lequel l’isolant est déjà incorporé est appliqué directement sur le mur.
Les isolants recommandés sont les suivants :
- Laines minérales (laine de verre ou de roche) avec pare-vapeur.
- Panneaux de polyuréthane ou polystyrène.
- Systèmes avec ossature métallique et plaques de plâtre.
Étanchéité, drainage et ventilation les : indispensables pour une isolation durable
Avant d’isoler un mur enterré, il est primordial de traiter les problèmes d’humidité. En effet, un mur humide réduit considérablement l’efficacité de l’isolant, voire le détériore. Des pré-requis en amont ou pendant les travaux sont indispensables pour assurer la longévité du système d’isolation mis en place.
Dans certains cas, notamment si l’humidité est trop importante ou le terrain trop en pente, les travaux peuvent s’avérer impossible.
S’assurer de l’étanchéité du mur
Pour améliorer l’étanchéité d’un mur enterré, trois solutions complémentaires sont possibles :
- La pose d’un revêtement bitumineux ou d’une membrane d’étanchéité à l’extérieur du mur.
- L’utilisation de barrières capillaires pour stopper les remontées d’humidité.
- L’application d’un enduit hydrofuge côté intérieur en complément.
La mise en place d’un système de drainage
L’installation d’un système de drainage permet d’assainir un logement trop humide. Cela consiste en la mise en place d’un drain périphérique au pied des fondations pour évacuer les eaux de ruissellement couplé à la pose de graviers filtrants et d’un géotextile pour protéger le système. Il est primordial d’effectuer une vérification régulière du bon fonctionnement du drainage.
Bien ventiler et aérer
Il est fortement conseillé, lorsque cela est possible, d’étendre le système de ventilation aux pièces aménagées en sous-sol.
L’isolation des murs enterrés est une étape essentielle pour améliorer la performance énergétique d’un bâtiment. Trop souvent ignorés, ces murs peuvent pourtant être une source majeure de pertes de chaleur et d’inconfort. En choisissant la bonne méthode (ITE ou ITI), en assurant une bonne étanchéité et en utilisant des matériaux adaptés, vous limiterez efficacement les déperditions thermiques.
Par Alexandre Masson