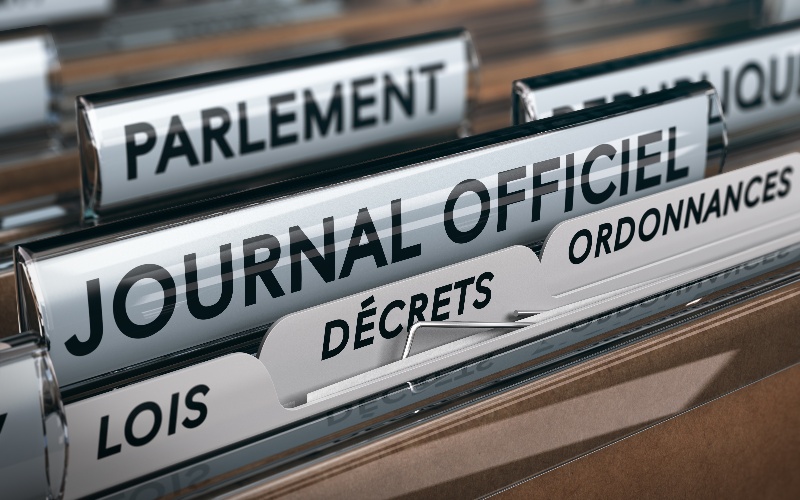RE2020 : la construction bois face au défi carbone
Publié le 01 octobre 2025, mis à jour le 06 octobre 2025 à 17h46, par Marie Gérald

La réglementation environnementale RE2020, entrée en vigueur en 2022, marque un tournant dans la décarbonation du bâtiment. Ses prochaines étapes, notamment en 2028, vont encore durcir les exigences carbone et redessiner les pratiques de la construction.
Parmi les filières directement concernées : celle du bois, souvent présenté comme le matériau vertueux par excellence. Mais la réalité est plus nuancée.
« La prochaine étape est la RE2028, prévue pour le logement, les bureaux et les nouveaux usages du tertiaire à partir du 1er janvier 2026 », rappelle Guillaume Meunier, consultant bas carbone à l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB).
Logement, bureaux et tertiaire : des trajectoires différentes
Dans le secteur résidentiel, les objectifs semblent atteignables. Les études montrent qu’il est possible de respecter les seuils 2028 sans recourir massivement aux matériaux biosourcés. « On peut construire en RE2028 sans bois ni chanvre, en s’appuyant sur trois leviers : l’architecture, le bon usage de la donnée et le réemploi », précise M. Meunier.
Cela ne signifie pas que les biosourcés disparaîtront, mais leur place pourrait être plus mesurée que prévue, nuançant certaines projections de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). La qualité de conception et la maîtrise des données deviennent déterminantes pour atteindre les seuils.
Pour les nouveaux usages du tertiaire, les informations sont encore limitées, mais les premiers seuils ne devraient pas représenter un frein immédiat. En revanche, le cas des bureaux est plus complexe : « Le seuil 2028 sera difficile à atteindre et nécessitera un recours significatif au bois », explique le consultant. Cela implique une adaptation des méthodes constructives, ainsi qu’une meilleure anticipation des coûts et de la logistique liées aux matériaux biosourcés.
La filière doit donc se préparer à une montée en puissance progressive du bois dans ce segment.
Une méthode française et des freins persistants
Le stockage carbone du bois constitue un enjeu central. La France utilise une méthode d’Analyse du cycle de vie (ACV) dite « dynamique », qui prend en compte l’évolution temporelle des émissions et valorise le stockage initial du carbone dans les matériaux biosourcés.
Contrairement à l’ACV classique, qui se contente de calculer les émissions sur l’ensemble du cycle, l’ACV dynamique permet de mieux refléter la contribution réelle des matériaux biosourcés à la neutralité carbone des bâtiments. « La France est aujourd’hui la seule à appliquer cette méthode », rappelle Guillaume Meunier.
L’indicateur stock C, intégré dans la RE2020, quantifie le carbone stocké et pourrait devenir un critère soumis à seuil, renforçant encore l’intérêt de ces matériaux.
Malgré ce cadre favorable, des freins techniques et économiques persistent. Les normes incendie imposent souvent de recouvrir les structures bois, ce qui augmente les coûts et limite la mise en valeur du matériau. Le prix reste légèrement supérieur à celui des solutions traditionnelles, même si l’écart tend à se réduire.
À cela s’ajoutent des contraintes assurantielles et des exigences techniques pour la durabilité et la résistance des constructions. Ces freins ralentissent parfois la prise de décision, mais les retours d’expérience et les innovations récentes permettent progressivement de les surmonter.
L’avenir passe par l’hybride
Pour relever ces défis, la construction hybride apparaît comme la solution la plus adaptée. Plutôt que d’opposer béton et bois, les concepteurs misent sur la complémentarité.
« Une bonne conception consiste à placer le bon matériau au bon endroit : béton bas carbone pour les parties massives et bois pour les zones légères », souligne-t-il. Les derniers étages, qui doivent rester légers pour ne pas surcharger la structure, sont ainsi très souvent réalisés en bois.
Cette logique encourage également une réflexion sur les essences et techniques utilisées. L’utilisation accrue des feuillus, mieux adaptés aux forêts françaises, s’impose comme une tendance forte. Le CLT feuillu se développe, tandis que le bambou ou le béton de chanvre ouvrent de nouvelles possibilités pour des solutions plus légères et durables. Ces approches permettent de diversifier les matériaux et de réduire la dépendance à un seul type de construction.
L’IFPEB accompagne ces transitions. Il publie des données de référence et des guides méthodologiques pour intégrer le carbone dès la conception. « L’objectif est que la question carbone soit prise en compte très tôt pour éviter les surcoûts et optimiser la conception », précise l'expert. L’institut agit sur trois axes : identifier les leviers de conception bas carbone, développer des outils pour réduire l’impact et fédérer les acteurs autour de pratiques communes.
La dynamique initiée par la RE2020, amplifiée par les Jeux olympiques de Paris 2024, a déjà renforcé la visibilité du bois et des biosourcés. Malgré certaines incertitudes, la tendance est positive. « La profession est désormais convaincue de l’intérêt de la mixité structurelle et de la nécessité d’élargir la palette de matériaux au-delà du béton », conclut Guillaume Meunier.
> Consulter notre magazine sur la construction bois
Propos recueillis par Marie Gérald