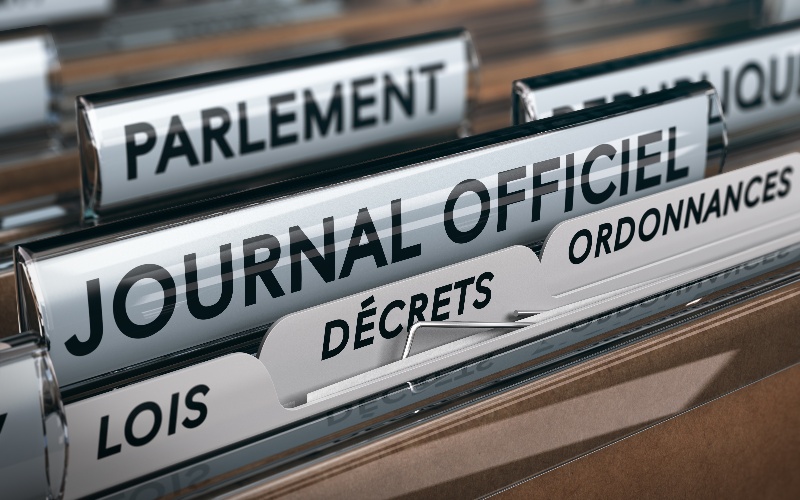RE2020 : trois ans après, quel bilan ?
Publié le 03 octobre 2025, mis à jour le 06 octobre 2025 à 16h27, par Marie Gérald

La transition écologique du secteur du bâtiment est bel et bien en marche. Depuis l’entrée en vigueur de la RE2020 en 2022, les acteurs de la construction se mobilisent pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments neufs. Trois ans plus tard, le moment est venu de dresser un premier bilan.
Le Hub, co-animé par l’IFPEB et Carbone 4, rappelle un point essentiel : l’ambition ne faiblit pas.Les ajustements de la réglementation doivent être vus comme des étapes nécessaires pour accompagner la filière, et non comme un recul. La France joue un rôle de pionnière en Europe, régulièrement citée en exemple dans les rapports internationaux. Elle est aujourd’hui rejointe par d’autres pays, comme la Suède, la Norvège et la Finlande, qui s’engagent eux aussi dans une démarche de décarbonation du bâtiment.
Pour rappel, la RE2020 repose sur trois grands piliers. Le premier est la sobriété énergétique, le second est la décarbonation de l’énergie, et le troisième est la décarbonation des matériaux, couplée à la garantie du confort d’été.
Des premiers résultats encourageants
Les premiers résultats des observatoires, qu’il s’agisse de l’OP2E ou du Hub, montrent des progrès significatifs. En deux ans seulement, l’empreinte carbone moyenne des logements collectifs neufs a baissé d’environ 20 %.
Certains projets vont même plus loin et atteignent dès aujourd’hui les seuils fixés pour 2028, voire pour 2031. Ces avancées sont liées à plusieurs leviers, comme l’amélioration des matériaux de construction, l’abandon progressif du gaz, ou encore la montée en qualité des données environnementales disponibles, ainsi que l’amorce d’une dynamique autour du réemploi des matériaux.
La période actuelle, entre 2025 et 2028, marque un véritable tournant. La sortie des énergies fossiles sera presque totale d’ici peu et les choix de matériaux vont devenir décisifs. Un enjeu majeur reste encore à relever : le stockage carbone. La révolution annoncée des matériaux biosourcés, tels que le bois, le chanvre ou la paille, n’a pas encore eu lieu.
Pourtant, sans eux, la capacité du bâtiment à stocker durablement du carbone pourrait être insuffisante pour atteindre les objectifs de neutralité fixés par la France.
Encore quelques inquiétudes
Le rapport Rivaton, publié en 2025, apporte de nouvelles perspectives. Il met en avant des avancées intéressantes, notamment en matière de formation, de qualité d’usage des bâtiments et d’expérimentation dans le domaine de la rénovation.
Mais il soulève aussi des inquiétudes, car certaines mesures proposées pourraient réduire de 5 à 10 % l’ambition climatique. Ce chiffre peut sembler faible, mais il représente en réalité l’effort global attendu entre 2025 et 2031. Pour la filière, il est donc essentiel de rester vigilante et de ne pas fragiliser les progrès déjà accomplis.
Décarboner les matériaux : la priorité numéro 1
L’avenir de la RE2020 repose notamment sur la décarbonation des matériaux, car c’est le premier poste d’émissions. La sortie des énergies fossiles doit être achevée et le stockage carbone assuré grâce à une montée en puissance du biosourcé. La qualité des données environnementales doit continuer à s’améliorer afin de fiabiliser les analyses et de maîtriser les coûts.
Enfin, l’optimisation de l’architecture doit être intégrée dès la conception des projets pour réduire leur empreinte carbone.
Les résultats obtenus depuis 2022 prouvent que la transition est possible et déjà amorcée. « Le message est clair : avancer ensemble, sans retour en arrière, car l’avenir de nos villes et de notre climat en dépend », ont-ils conclu.
→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.
Par Marie Gérald