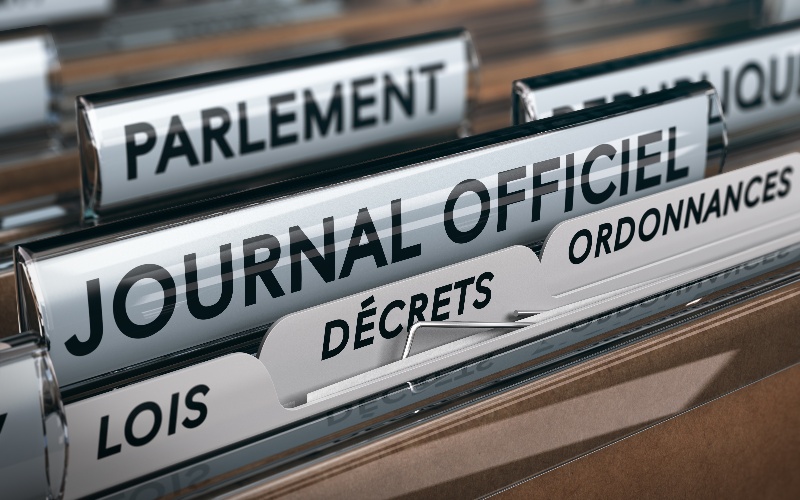Notre-Dame de Paris : une réplique de la flèche bientôt érigée dans la Nièvre
Publié le 14 octobre 2025, mis à jour le 03 novembre 2025 à 10h44, par Nils Buchsbaum

Tout le monde a encore en tête les terribles images de la flèche de Notre-Dame s’écroulant dans la chaleur des flammes, le 15 avril 2019. Après la fin du chantier d'envergure qui a mené à la réouverture de la cathédrale en décembre 2024, un autre projet s’annonce : des répliques à l’identique de la flèche et des charpentes médiévales de la cathédrale érigées à Pougues-les-Eaux (Nièvre) ; elles pourraient voir le jour dès 2029.
Ce lundi 13 octobre, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, l’association Restaurons Notre-Dame, créée au lendemain de l’incendie par le Nivernais Pascal Jacob - qui en est désormais président d’honneur -, a dévoilé les contours dudit projet. L'idée : « redonner vie à la flèche et aux charpentes de Notre-Dame de Paris au cœur de la Nièvre ».
16 millions d'euros financés uniquement par le mécénat
C’est sur le Mont Givre, un site naturel de six hectares, en lieu et place d’un bâtiment désaffecté détenu par l’hôpital de Nevers, que devrait être construit l’édifice. Il sera complété par 1 000 m² d’espaces intérieurs. L’ensemble offrirait au public un espace culturel et immersif.
La réplique de la flèche culminera à près de 80 mètres de hauteur, soit environ 210 mètres au-dessus du niveau de la Loire, et dominera ainsi l’ensemble de la région, dont la forêt des Bertranges. Mais Pascal Jacob prévient : « Nous avons choisi ce site mais nous engageons maintenant les discussions avec Nevers Agglomération et la Ville de Pougues-les-Eaux pour en étudier les conditions d’accueil. S’ouvre une phase cruciale, qui durera plusieurs mois, le temps d’adapter le projet à ce site, de travailler avec les services de l’État, de lancer les études architecturales, techniques et de finaliser le budget, étapes préalables à la campagne de financement prévue au 1er trimestre 2026. »
Estimée à 16 millions d’euros, la construction sera intégralement financée par le mécénat, avec une campagne lancée dès novembre, suivie d’une autre nationale et internationale en 2026.
Le projet bénéficie déjà de partenariats de poids. L’Office national des forêts (ONF), déjà engagé aux côtés de l’association Restaurons Notre-Dame, participera au comité scientifique du projet. Les institutions compagnonniques voient aussi dans ce projet un vecteur déterminant de valorisation et de transmission des savoir-faire ancestraux.
Un chantier-spectacle sur plusieurs années
La nouvelle flèche sera construite à l’identique de l’ouvrage original, créé par l’architecte Viollet-le-Duc au XIXème siècle, donc en chêne et en verre, selon les techniques ancestrales des bâtisseurs de cathédrales.
Le projet souhaite rendre hommage à l’artisanat d’excellence et au patrimoine immatériel de la culture française mais plus qu’une nouvelle démonstration du savoir-faire des artisans français, l’objectif est aussi pédagogique. Il s’agit de « rendre visible l’invisible », c’est-à-dire découvrir, de l’intérieur, la complexité de tels ouvrages et les techniques utilisées pour les réaliser.
Un centre d’interprétation consacré aux métiers d’art, aux savoir-faire d’excellence et à la valorisation des ressources forestières locales (dont le massif des Bertranges, qui a fourni de nombreux chênes pour Notre-Dame de Paris) sera ainsi installé sur le site. À travers des espaces ludiques, des ateliers participatifs, des expositions et des dispositifs immersifs, le public pourra (re)découvrir la genèse de ce chef-d’œuvre universel et les gestes précis qui ont façonné son histoire.

Après la finalisation de la réplique de la flèche en 2029, un chantier-spectacle devrait se produire sur plusieurs années, consacré à la reconstitution des charpentes médiévales. Plusieurs dizaines de compagnons itinérants y travailleront devant le public, permettant à chacun de découvrir en direct les gestes artisanaux.
Quant aux institutions académiques et universitaires associées au projet, elles offriront aux jeunes et aux étudiants l’opportunité de découvrir les métiers associés à de tels chantiers ainsi que les technologies contemporaines mobilisées dans la restauration, tous métiers confondus, du numérique à la modélisation 3D en passant par l’intelligence artificielle.
→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.
Par Nils Buchsbaum